
B-Les conséquences de ces changements au niveau de la population de la Brévenne
1) L'indice Poissons Rivières(IPR)
l'IPR est un indice français normalisé et validé par l'AFNOR (groupe international qui s'occupe de normaliser, certifier et édifier des services techniques et professionnels) en mai 2004 qui permet d'étudier le peuplement des poissons « l'ichtyofaune » dans la rivière. Il indique la qualité de l'eau de la rivière. Il conjecture le fait que la faune piscicole et l'état du milieu sont liés, plus particulièrement l'état écologique général du milieu découle de la faune piscicole de ce milieu-dit
L'IPR calcule à l'aide de la pêche électrique (décharge électrique envoyée au poisson qui l'attire et le paralyse, ce qui le fait remonter à la surface. On utilise cette technique car elle est simple et rapide, cependant si on l'utilise mal elle peut tuer ou blesser les peuplements piscicoles) l'écart qu'il y a entre le milieu d'origine, c'est-à-dire celui qu'il devrait être sans aucune perturbation humaine, et le milieu actuel, dégradé par l'homme et ses actions.
Il modélise la population aquatiques, en particulier les poissons, dans une rivières aux conditions initiales (non modifiées) selon plusieurs critères :
-la distance du point d'échantillonnage à la source
-la superficie du bassin-versant (portion du cours d'eau où se réunissent l'ensemble des eaux de la rivière vers un même exutoire)
-largeur et profondeur moyenne de la station
-température moyenne de l'air (de janvier à juillet)
Cet indice évalue les paramètres environnementaux (surface bassin, pente, largeur..) et biologique (comme le nombre d'espèces...) ce qui permet de caractériser les probabilités d’occurrence et d'abondance pour les 34 espèces de poissons les plus couramment rencontrées. La note de L'IPR varie de zéro à l'infini mais dans la pratique, il ne peut excéder 150 pour une zone extrêmement endommagées.
On peut se référer à cinq classes de qualité en fonction des notes de l'IPR:
- Hors classe : >36 = très mauvaise qualité, peuplement quasi inexistant ou complétement
- Dégradé : entre 25 et 36= mauvaise qualité, peuplement fortement perturbé
- Perturbé: entre 16 et 25= qualité médiocre, peuplement perturbé
- Subréférent : entre 7 et 16= bonne qualité, peuplement faiblement perturbé subréféretiel
- Référentiel: <7 = excellente qualité, peuplement conforme.
L'IPR est un indice qui ne prend pas en compte la biomasse et la taille des individus, il a été effectué sur 41 stations au niveau de la Brevenne dont les résultats confirment la situation décrite par les autres indices. En effet : on observe que seulement 1 station a un IPR excellent, 13 d'entre elles sont bonnes, 13 sont également médiocres, 8 sont mauvaises, 1 est très mauvaise et 5 ne contiennent aucun poisson indiquant un IPR très concertant. Ainsi on peut constater que sur 41 stations, 28 sont dans une situation critique ce qui représente plus de 65% des stations étudiées.
La Brevenne est donc une rivière qui est grandement dégradée dès l'amont.
Au delà des informations sur la présence ou l’absence de telle ou telle espèce, l’analyse des résultats des différents échantillonnages permet d’approcher la qualification de l’état des milieux aquatiques. Le poisson est un organisme intégrateur des conditions du milieu, c’est à dire que les peuplements sont capables de résister lorsque les conditions du milieu deviennent moins favorables, et en dehors des mortalités aiguës, on n’observe pas nécessairement de grands changements immédiats du peuplement.En revanche, si l’agression est grave (pollution aiguë par exemple) ou si les conditions environnementales se modifient durablement, le peuplement va changer, dans le premier cas par la disparition brutale de certaines espèces, dans le second cas par la mise en place d’un nouvel équilibre d’espèces. Ainsi, l’observation des poissons constitue un moyen d’évaluer l’état de l’environnement aquatique.
L'IPR prend en compte plusieurs facteur tels que :
distance du point d'échantillonnage à la source ;
-
superficie du bassin-versant ;
-
largeur et profondeur moyenne (tirant d'eau) de la station ;
-
température moyenne de l’air (de janvier à juillet) ;
relation au bassin hydrographique.
L'IPR a été normalisé sous l'égide de l'AFNOR qui l'a validé en mai 2004, de manière à ce qu'il puisse être utilisé dans différents environnements, en France métropolitaine
2) Généralités



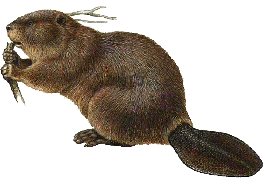


La truite fario est l'espèce la plus présente au niveau de la Brevenne, en effet son occurrence est de 80 % mais elle devrait être de 100 %, cependant, cela nécessiterait une qualité de l'eau irroprochable.
De cette façon, la présence de cette espèce et sa survie imagent beaucoup la situation au niveau de la rivière toute entière. Comme nous pouvons le remarquer, les problèmes jouant sur la qualité de l'eau ainsi que les problèmes d'habitats ont entraîné la disparition de cette espèce à plusieurs endroits voire la réimplantation de cette dernière. De plus les effectifs de cette espèce sont estimés faibles à très faibles. De cette manière, même si certains poissons arrivés à maturité arrivent à perdurer, la reproduction et la survie de la truite fario est compromise par la qualité de l'eau et la chaleur de celle-ci en particulier dans les périodes estivales.
Le vairon est une espèce présente également dans la Brevenne dont l'occurrence est de 25 %.
Cette espèce est absente de façon très anormale sur la plus grande partie de la rivière car on voit que seulement 30 % des stations étudiées en contiennent. On peut assister pour cette espèce aussi à une diminution de sa présence due à l'étiage (la période de l'année où le niveau du court d'eau est le plus bas) et à la pollution. Malheureusement, contrairement à
la truite fario cette espèce ne peut peut être réimplantée à cause des modifications de terrains qui ont entraîné la formation d'obstacles ne permettant plus la survie de cette espèce dans le milieu.
La Loche franche est une espèce qui fonctionne dans le sens inverse. En effet, cette espèce est favorisée lors d'apports organiques. Ainsi plus on la retrouve, plus cela est mauvais signe. C'est le cas dans la Brévenne : on retrouve cette espèce sur 50 % des stations étudiées. Ce qui est signe de perturbation.
Le bardeau méridional est une espèce autochtone de l'Europe méridionale. Cette espèce a le statue d'espèce semi- menacée dans la liste rouge mondiale de l'UICN (2009). Cette espèce bénéficie à ce titre d'une protection nationale et européenne. Au niveau de la Brevenne, la population de cette espèce s'étend sur 1700 mètres délimitée par un seuil infranchissable. Au cours de la campagne de juin 2009 pour recenser la présence de cette espèce lors de sa reproduction, aucun alevin (jeune poisson) n'a été pêché et aucun individu d'un an non plus. L’inondation de novembre 2008 a donc sûrement tué les jeunes poissons, ne résistant pas aux courants
Le castor européen est une espèce qui n'est pas présente sur la Brevenne mais on suppose qu'elle l'était par le passé. C'est une espèce
très exigeante sur la qualité des eaux et nécessite pour vivre des salicacées tels que des saules et des peupliers qui sont absents dans ces endroits. Ces critères sont aujourd'hui impossibles à respecter avec une qualité de l'eau moyenne et une modification des espèces présentes.
Le goujon est une espèce naturellement présente dans la Brevenne. Or cette espèce est favorisée par les changements de températures mais ne supporte pas pour autant les températures trop froides et trop chaudes (supérieures à 28°C). Comme nous le savons, des écarts de températures assez importants ont été observés au sein de la Brevenne ce qui expliquerait la présence de cette espèce.
En conclusion, nous avons pu voir, que les espèces présentent dans la vallée de la Brevenne sont représentatives de son état. En effet, l'absence à certains endroits du vairon et du bardeau méridional et la présence de la loche franche et du goujon nous indiquent que la qualité de l'eau laisse à désirer et est sensible. Pour remédier à cela, des travaux tels que les réhabilitations des stations d'épuration des eaux usées de tarare, Sarcey et Saint-Pierre La Palud entrepris entre 2006 et 2008 ont permis d'améliorer la qualité de l'eau au niveau de la Turdine mais pas encore au niveau de la Brevenne. Des aménagements des habitats au niveau des obstacles ont également été effectués pour que les poissons puissent les franchir sans problème.